


Mise à jour du 23/08/2025
Tornac
La commune de Tornac s’étend des derniers contreforts des Cévennes à la plaine viticole et la garrigue.
Elle est constituée de 18 hameaux bâtis pour les plus pittoresques sur le piémont cévenol et qui parsèment son territoire juste à côté de la commune d’Anduze.
 Le Château :
Il
Il a été construit au XII° siècle, et il surplombe la rive droite du Gardon d’Anduze à un emplacement stratégique qui lui permettait de protéger l’entrée vers Anduze et les Cévennes.
Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.
Le Château :
Il
Il a été construit au XII° siècle, et il surplombe la rive droite du Gardon d’Anduze à un emplacement stratégique qui lui permettait de protéger l’entrée vers Anduze et les Cévennes.
Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.
Le nom primitif est Sandeiren ou Sandeyren et, par altération aux XV° et XVI° siècles, Saint-Deyran. Le château portera le nom du village de Tornac vers la fin du XVII° siècle.
Construction probable de la première tour de guet (tour Sandeyren) par Bremond d'Anduze sur un ancien site romain. Entre 1549 et 1566 Construction du château par Bremond de la Jonquiere bourgeois d'Anduze. XVII° Henri de La Fare hérite du château et le restaure. Il fut pris par les hommes de Jean Cavalier en 1703 puis Incendié en 1792 par les révolutionnaires, pour en fin être Sequestré comme bien national et vendu à la 1793 par morceaux. XVIII° création des célèbres jardin du château. Lors de la seconde guerre mondiale en aout 1944 il fut le lieu de combats entre résistants et troupe nazi, de nombreux combattants y trouvèrent la mort.
Le donjon carré s'apparente aux tours élevées en bas Languedoc aux XI° et XII° siècles, présentant un plan en forme de parallélogramme et percées de rares ouvertures. Probablement édifiée sur un emplacement déjà reconnu du temps de l'occupation romaine, elle était destinée au guet et à la transmission de signaux.
De plan carré, la tour est érigée sur un roc taillé. La base de la porte voûtée en berceau est à un mètre au-dessus du roc. Les constructions du XVI° siècle s'organisent autour.
Abbaye de Tornac : Le Monastère de Tornac (Monastère Saint-Étienne), sont un ensemble de ruines monastiques dont on peut voir les vestiges, qui donnent une bonne impression de ce à quoi devait ressembler l'abbaye à son apogée.
Le monastère partiellement détruit, était le siège d’une abbaye fondée au VII° siècle par des moines bénédictins affiliés à l’ordre de Cluny vers 1080. Ruiné au VIII° siècle, il passe sous la protection de Charlemagne au IX° siècle et est ruiné une nouvelle fois au XVI° siècle, lors des guerres de religion.
Le monastère porta de nombreux que l'on retrouve dans des sources anciennes : Abbatia Tornacensis (1150), Prior de Tornaco (1152), Tornacense monasterium (cartulaire de la cathédrale de Nîmes en 1156), Al monestier de Tornac (1174), Monasterium de Tornaco (1269).
Propriété privée, il est visible de l’extérieur.
Église Saint-Baudile : L'église de style romane se situe à 700 m au sud-ouest du village de Tornac.
Elle se dresse dans un décor de vignes et de cyprès, en vue des ruines de l'abbaye de Tornac. L'église de Tornac est édifiée en style roman au XII° siècle par des moines chassés de leur monastère nîmois et qui avaient trouvé refuge au monastère de Tornac. La première mention de la paroisse apparaît en 1345 dans le cartulaire de la seigneurie d'Alais : Parrochia de Tornaco. Elle apparaît ensuite en 1437 sous le nom de Parrochia Sancti Baudilii de Tornaco : alors que le monastère lui-même était placé sous le vocable de saint Étienne, le patron de la paroisse était donc saint Baudile, évangélisateur de Nîmes et martyr du III° siècle. La communauté de Tornac faisait partie de la viguerie d'Anduze et du diocèse de Nîmes, avant de faire partie du diocèse d'Alais.
Au XVI° siècle, devenue un simple prieuré conventuel de l'ordre de Cluny, elle prend le double vocable de Saint-Étienne-et-Saint-Sauveur : Saint-Sauveur et Saint-Étienne de Tornac (1579). L'église a connu de nombreuses vicissitudes au cours des siècles : elle a en effet été détruite au XVI° siècle, reconstruite au XVII° siècle et brûlée en 1702.
L'église est un édifice à nef unique et à chevet semi-circulaire. Elle adopte un plan en forme de croix latine grâce à la présence de deux petites chapelles qui font office de transept. Extérieurement, ces chapelles font saillie à hauteur de la travée de chœur et du début de la nef.
L'église est édifiée en pierre de taille assemblée en moyen appareil et est recouverte de tuiles. La maçonnerie présente des traces d'opus monspelliensis (appareil alterné de Montpellier), comme par exemple au niveau du chevet. On distingue également des traces de réfection, reconnaissables à la couleur blanche des pierres.
L'église possède un beau chevet semi-circulaire édifié en pierre de taille sur un soubassement en moellon. Ce chevet est orné d'arcatures reposant sur des modillons géométriques, ainsi que d'une frise de dents d'engrenage. Il est percé d'une fenêtre absidiale axiale, à double ébrasement, et d'une fenêtre orientée au sud, à simple ébrasement. Au nord, par contre, le chevet ne présente aucune ouverture.
La façade occidentale est soutenue par deux puissants contreforts. Elle possède une porte en plein cintre à double ébrasement, dont l'arc interne présente des claveaux de couleur alternée et est orné d'un arc torique. Le pignon est percé d'une baie cintrée à simple ébrasement et est surmonté d'un clocheton à baie campanaire unique.
Le temple : Lieu de culte de la communauté, il fut construit au début du XIXe siècle avec le concours de la population protestante.
 Le Château :
Il
Il a été construit au XII° siècle, et il surplombe la rive droite du Gardon d’Anduze à un emplacement stratégique qui lui permettait de protéger l’entrée vers Anduze et les Cévennes.
Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.
Le Château :
Il
Il a été construit au XII° siècle, et il surplombe la rive droite du Gardon d’Anduze à un emplacement stratégique qui lui permettait de protéger l’entrée vers Anduze et les Cévennes.
Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.
Le nom primitif est Sandeiren ou Sandeyren et, par altération aux XV° et XVI° siècles, Saint-Deyran. Le château portera le nom du village de Tornac vers la fin du XVII° siècle.
Construction probable de la première tour de guet (tour Sandeyren) par Bremond d'Anduze sur un ancien site romain. Entre 1549 et 1566 Construction du château par Bremond de la Jonquiere bourgeois d'Anduze. XVII° Henri de La Fare hérite du château et le restaure. Il fut pris par les hommes de Jean Cavalier en 1703 puis Incendié en 1792 par les révolutionnaires, pour en fin être Sequestré comme bien national et vendu à la 1793 par morceaux. XVIII° création des célèbres jardin du château. Lors de la seconde guerre mondiale en aout 1944 il fut le lieu de combats entre résistants et troupe nazi, de nombreux combattants y trouvèrent la mort.
Le donjon carré s'apparente aux tours élevées en bas Languedoc aux XI° et XII° siècles, présentant un plan en forme de parallélogramme et percées de rares ouvertures. Probablement édifiée sur un emplacement déjà reconnu du temps de l'occupation romaine, elle était destinée au guet et à la transmission de signaux.
De plan carré, la tour est érigée sur un roc taillé. La base de la porte voûtée en berceau est à un mètre au-dessus du roc. Les constructions du XVI° siècle s'organisent autour.
Abbaye de Tornac : Le Monastère de Tornac (Monastère Saint-Étienne), sont un ensemble de ruines monastiques dont on peut voir les vestiges, qui donnent une bonne impression de ce à quoi devait ressembler l'abbaye à son apogée.
Le monastère partiellement détruit, était le siège d’une abbaye fondée au VII° siècle par des moines bénédictins affiliés à l’ordre de Cluny vers 1080. Ruiné au VIII° siècle, il passe sous la protection de Charlemagne au IX° siècle et est ruiné une nouvelle fois au XVI° siècle, lors des guerres de religion.
Le monastère porta de nombreux que l'on retrouve dans des sources anciennes : Abbatia Tornacensis (1150), Prior de Tornaco (1152), Tornacense monasterium (cartulaire de la cathédrale de Nîmes en 1156), Al monestier de Tornac (1174), Monasterium de Tornaco (1269).
Propriété privée, il est visible de l’extérieur.
Église Saint-Baudile : L'église de style romane se situe à 700 m au sud-ouest du village de Tornac.
Elle se dresse dans un décor de vignes et de cyprès, en vue des ruines de l'abbaye de Tornac. L'église de Tornac est édifiée en style roman au XII° siècle par des moines chassés de leur monastère nîmois et qui avaient trouvé refuge au monastère de Tornac. La première mention de la paroisse apparaît en 1345 dans le cartulaire de la seigneurie d'Alais : Parrochia de Tornaco. Elle apparaît ensuite en 1437 sous le nom de Parrochia Sancti Baudilii de Tornaco : alors que le monastère lui-même était placé sous le vocable de saint Étienne, le patron de la paroisse était donc saint Baudile, évangélisateur de Nîmes et martyr du III° siècle. La communauté de Tornac faisait partie de la viguerie d'Anduze et du diocèse de Nîmes, avant de faire partie du diocèse d'Alais.
Au XVI° siècle, devenue un simple prieuré conventuel de l'ordre de Cluny, elle prend le double vocable de Saint-Étienne-et-Saint-Sauveur : Saint-Sauveur et Saint-Étienne de Tornac (1579). L'église a connu de nombreuses vicissitudes au cours des siècles : elle a en effet été détruite au XVI° siècle, reconstruite au XVII° siècle et brûlée en 1702.
L'église est un édifice à nef unique et à chevet semi-circulaire. Elle adopte un plan en forme de croix latine grâce à la présence de deux petites chapelles qui font office de transept. Extérieurement, ces chapelles font saillie à hauteur de la travée de chœur et du début de la nef.
L'église est édifiée en pierre de taille assemblée en moyen appareil et est recouverte de tuiles. La maçonnerie présente des traces d'opus monspelliensis (appareil alterné de Montpellier), comme par exemple au niveau du chevet. On distingue également des traces de réfection, reconnaissables à la couleur blanche des pierres.
L'église possède un beau chevet semi-circulaire édifié en pierre de taille sur un soubassement en moellon. Ce chevet est orné d'arcatures reposant sur des modillons géométriques, ainsi que d'une frise de dents d'engrenage. Il est percé d'une fenêtre absidiale axiale, à double ébrasement, et d'une fenêtre orientée au sud, à simple ébrasement. Au nord, par contre, le chevet ne présente aucune ouverture.
La façade occidentale est soutenue par deux puissants contreforts. Elle possède une porte en plein cintre à double ébrasement, dont l'arc interne présente des claveaux de couleur alternée et est orné d'un arc torique. Le pignon est percé d'une baie cintrée à simple ébrasement et est surmonté d'un clocheton à baie campanaire unique.
Le temple : Lieu de culte de la communauté, il fut construit au début du XIXe siècle avec le concours de la population protestante.
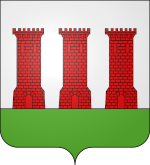 Tornac est riche d’un patrimoine historique encore présent aujourd’hui.
Tornac est riche d’un patrimoine historique encore présent aujourd’hui.
Tornac Est habité par des Gaulois dès l'âge du bronze, aux IV° et V° siècles avant Jésus-Christ.
La tour sera l’élément de référence pour désigner le pays et plus particulièrement le monastère bénédictin installé au fond de la plaine – Tornagus Sancti Stefani monasterium. Après la chute de l’Empire Romain (V° s) s’installent les premiers chrétiens avec l’apparition de nouveaux lieux de culte et surtout l’installation du monothéisme. Charlemagne, étendant son empire, s’appuie sur les organismes religieux chrétiens. Il leur accordera des pouvoirs religieux, politiques, économiques et même parfois, de justice. Les seigneurs s’organisent, se christianisent et assurent le bras armé de cette nouvelle société.
Le Château de Tornac se situe sur un mamelon rocheux dominant le Gardon, l’entrée d’Anduze et la plaine. Ce lieu stratégique fut occupé dès le néolithique par l’homme. Les romains ont dû y construire une première tour de guet en bois. Durant la révolution, le 4 avril 1792, la population est désespérée et certains individus décident d’incendier les châteaux de la région. Le château de Tornac sera détruit totalement à la stupeur d’un grand nombre d’habitants. M. de Montbuisson, son propriétaire absent du château, à cette date, est considéré comme fugitif. En fait, il était retenu à Paris par Marie-Antoinette pour dette envers celle-ci (perte aux jeux). En 1793, le château sera vendu comme « bien national » ainsi que les terres et dépendances. Le bâtiment tombera dans l’oubli jusqu’en 1971, date à laquelle les Amis du Château de Tornac entreprendront le sauvetage de ces quelques restes.
Cette tour prendra le nom de Sandeyran (lieu de l’aire) lors de la christianisation de la région par les moines du Monastère. La tour prendra au XI° siècle sa forme actuelle en pierre. Elle faisait partie du système de tours à signaux des Bermonds d’Anduze qui partait de la mer jusqu’à Florac. Elle mesure 25 m de haut sur trois étages avec une citerne au rez-de-chaussée. Cette tour donnera son nom au village de Tornac ( ac = lieu et tor = tour).
Un premier “castrum” attesté au XII° siècle fut construit autour de la tour de Sandeyran. C’est là que fut célébré en 1261 le mariage de Sibille de Montursi épousant Pierre de Sandeyran, cérémonie au cours de laquelle, selon l’usage, elle rédigea son testament.
Bermond de la Jonquière construisit un nouveau château en ajoutant une aile Renaissance, celle que nous voyons aujourd’hui. La construction dura de 1549 à 1566. Quelques années plus tard, sa veuve dictera son testament dans la grande salle du château ( nous sommes au XVI° siècle). Le château inconfortable ne sera pas habité en permanence. En hiver, le seigneur se réfugie au Mas Neuf (Trial) ou à la métairie de la Madeleine (Bellefont = belle fontaine).
Le chemin traversant les bois était le chemin de St Hippolyte du Fort à Anduze (la route actuelle n’existait pas). Passaient en ce lieu, les routes du sel, de la soie, des minerais, vers les foires (Beaucaire), la transhumance et divers charrois. Les nombreux échanges entre la mer et les Cévennes passaient au pied de la tour et les seigneurs d’Anduze ainsi que les moines y prélevaient des impôts.
Durant les guerres de religion au XVII° siècle, en janvier 1621, une garnison sera installée dans la tour avec six soldats, par le Duc de Rohan, chef des armées protestantes. Un barrage de terre et de bois sera construit entre le château et la colline dominant le Gardon de l’autre côté. Une tour (Tour de Paulhan) encore visible complétait le dispositif.
Par succession aux XVII° / XVIII° siècle, le château deviendra la propriété de la famille De la Fare. Pour affirmer leurs richesses, les De la Fare feront construire un magnifique jardin partant du château et s’étendant jusqu’au Gardon. Ce jardin digne de celui des Tuileries – nous dit l’inspecteur du roi Louis XV était ouvert à la population qui y célébrait les mariages et autres réjouissances. Malheureusement, le gendre de M. de Montbuisson décide de détruire ces jardins à la fin du XVIII° siècle pour des raisons d’économie.
En contrebas du château, le hameau du “Trial” était le lieu où l’on triait les moutons lors de la transhumance. Au Moyen Âge, trois impôts y étaient prélevés: le droit d’agnelage, une censive sur le nombre de bêtes et le temps de stationnement ainsi que le droit de fumage.
En 1944, le château sera le refuge d’une garnison de maquisards qui détruiront une colonne allemande.


